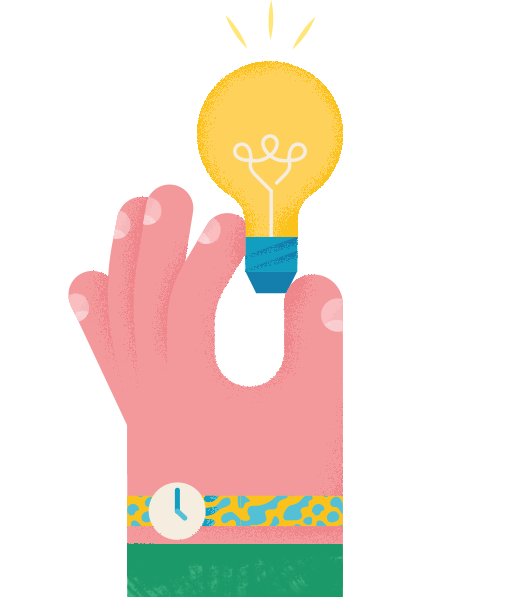
Il est plutôt rare qu’un mot soit inventé de toutes pièces, sans avoir de lien avec des éléments existant en français. En général, on assemble, fusionne ou transforme des mots ou des parties de mots pour en former un nouveau. Voici quelques-uns des procédés utilisés pour créer un néologisme.
1) La dérivation
Exemples
Les mots suivants sont formés par dérivation :
- Télétravailleur, télétravailleuse :
+
préfixe télé-, « à distance »
+
base travail- (travailler sans sa terminaison verbale)
+
suffixe -eur ou -euse, « personne qui fait l’action »
télétravailleur, télétravailleuse, « personne qui travaille à distance »
- Clicophobie (un des mots gagnants du CCL 2020) :
+
o pour séparer la suite de consonnes cph (qui serait difficile à prononcer)
+
suffixe -phobie, « peur de quelque chose »
clicophobie, « peur de cliquer »
- Sociomuselage (un des mots gagnants du CCL 2020) :
+
préfixe socio-, « indique un lien avec la société »
+
base musel- (museler sans sa terminaison verbale)
+
suffixe -age, « action ou résultat de »
sociomuselage, « action de museler, dans le contexte d’une société »
- Morpho-intimidation (un des mots gagnants du CCL 2022) :
+
préfixe morpho-, « forme, apparence »
+
trait d’union pour séparer la suite de voyelles oi (puisqu’on pourrait se demander si elle doit se prononcer wa)
+
base intimid- (intimider sans sa terminaison verbale)
+
suffixe -ation, « action ou résultat de »
morpho-intimidation, « action d’intimider une personne en raison de son apparence »
Activité
Observez les mots dérivés suivants. Ils sont formés d’une base (consomm-) et d’au moins un préfixe ou un suffixe. Associez chaque mot à sa définition.
Mots
1° Consommateur 2° Déconsommation 3° Surconsommation 4° Consommateurisme 5° Autoconsommation
Définitions
A
Action de consommer une ressource qu’on produit soi-même.
B
Idéologie qui fait la promotion de la consommation.
D
Consommation excessive.
E
Tendance à réduire sa consommation.
2) Le télescopage (mot-valise)
- Le télescopage consiste à combiner deux mots existants pour en créer un nouveau, appelé mot-valise. (Il est rarement approprié de combiner plus de deux mots, car le mot résultant risque de se comprendre difficilement.)
-
On forme généralement les mots‑valises en combinant les premières syllabes d’un mot aux dernières syllabes d’un autre mot. Il arrive aussi que l’un des deux mots soit conservé en entier.
-
Si une lettre ou un son est commun aux deux éléments qui forment un mot-valise, on l’utilise souvent pour lier les éléments.
-
Il est essentiel que la base de chaque élément qui compose le mot‑valise soit reconnaissable; conserver uniquement quelques lettres de chacun n’est pas suffisant. Par exemple, on peut se demander ce que désignerait le mot‑valise fictif pomcam. Un camion de pompier? Une caméra de pompiste? Une pomme campagnarde?
-
Il faut éviter de ne conserver que le préfixe ou le suffixe des mots de départ, car le sens de leur base est alors perdu. On ne pourrait, par exemple, créer le mot‑valise fictif camiste pour désigner une caméra de pompiste, car le suffixe ‑iste n’est pas suffisant pour rendre pompiste.
-
Il ne faut pas non plus conserver un élément qui pourrait être confondu avec un préfixe ou un suffixe. Par exemple, pancourt, au lieu de pantacourt, ne permettrait pas de désigner un pantalon qui s’arrête entre le genou et la cheville, puisque pan‑ est aussi un préfixe qui a le sens de « tout ».
-
En général, la classe de mots du mot‑valise correspond à celle du dernier élément entrant dans sa formation.
Exemples
Les mots suivants sont des mots-valises. Le découpage syllabique est présenté en fonction des syllabes orales, c’est-à-dire des groupes de sons constitués d’une voyelle prononcée et, facultativement, d’une ou de plusieurs consonnes, que l’on produit en une seule émission de la voix.
- Divulgâcher :
- Ce mot-valise est formé à partir des mots divulguer et gâcher.
- Les deux premières syllabes de divulguer (di-vul-guer) et les deux syllabes de gâcher (gâ-cher) sont conservées; le g est commun aux deux mots.
- Le nouveau mot est un verbe, comme gâcher.
- Pour former un nom dérivé désignant une personne, on remplace la terminaison ‑er par le suffixe ‑eur ou ‑euse, « qui fait l’action » : divulgâcheur, divulgâcheuse.
- Clavardage :
- Ce mot-valise est formé à partir des mots clavier et bavardage.
- La première syllabe de clavier (cla-vier) et les deux dernières syllabes de bavardage (ba-var-dage) sont conservées; le v est commun aux deux mots.
- Le nouveau mot est un nom masculin, comme bavardage.
- Pour former un verbe dérivé, on remplace le suffixe ‑age par la terminaison ‑er : clavarder.
- Conséconscient, conséconsciente (un des mots gagnants du CCL 2022) :
- Ce mot-valise est formé à partir des mots conséquence et conscient, consciente.
- Les deux premières syllabes du mot conséquence (con-sé-quence) et les deux syllabes du mot conscient (con-scient), consciente (con-sciente) sont conservées; le son k est commun aux deux mots.
- Le nouveau mot est un adjectif, comme conscient, consciente.
- Pour former un nom dérivé, on remplace le suffixe ‑ent ou ‑ente par le suffixe ‑ence, « caractéristique, état ou qualité » : conséconscience.
- Cosméceutique :
- Ce mot-valise est formé à partir des mots cosmétique et pharmaceutique.
- Les deux premières syllabes de cosmétique (cos-mé-tique) et les deux dernières syllabes de pharmaceutique (phar‑ma‑ceu‑tique) sont conservées.
- Le nouveau mot peut être un nom féminin ou un adjectif, comme pharmaceutique.
Activité
Observez les paires de mots suivantes; elles se combinent pour former des mots-valises. Trouvez les mots qu’elles forment.
NAVIGUER et ERRER
Passer du temps à naviguer au hasard sur Internet, à errer de lien en lien, au point d’en oublier l’objet de sa recherche initiale.
PLACOTER et TROTTOIR
Espace public urbain aménagé en bordure d’un trottoir et destiné à la détente des passants.
CAFÉTÉRIA et AUDITORIUM
Salle utilisée à la fois comme salle de repas et comme salle de spectacle.
TEXTO et ÉTIQUETTE
Ensemble des conventions de bienséance régissant l’échange de textos entre des personnes.
ANIMATION et ÉLECTRONIQUE
Branche de la robotique qui consiste à concevoir et à animer des personnages robotisés.
Recommencer
3) La composition
- La composition consiste à juxtaposer, avec ou sans traits d’union, des mots qui existent déjà pour en créer un nouveau, appelé mot composé. Par exemple : grand-mère, garde-fou, brosse à dents, avantage numérique.
- Le mot composé est vu comme une seule unité et désigne une réalité à part entière, et ce, même si chacun des mots qui le composent a un sens qui lui est propre. Dans concepteur rythmique et conceptrice rythmique, par exemple, on trouve les noms concepteur et conceptrice, « personne qui conçoit quelque chose », et l’adjectif rythmique, « qui est soumis à un rythme » ou « qui est fondé sur un rythme ». Un concepteur rythmique ou une conceptrice rythmique est une personne qui crée la partie rythmique et l’accompagnement de pièces musicales.
- Comment savoir si une suite de mots juxtaposés constitue un mot composé?
- L’un des indices est qu’on ne peut insérer d’autres mots à l’intérieur du mot composé. Par exemple, dire « une pomme au four de terre » serait incorrect. Ainsi, on peut conclure que pomme de terre est un mot composé.
Exemples
Les mots suivants sont des mots composés :
- Chargeur portatif :
- chargeur est le noyau;
- portatif est un adjectif complément du nom chargeur.
- Environnement numérique d’apprentissage :
- environnement est le noyau;
- numérique est un adjectif complément du nom environnement;
- d’apprentissage est un groupe prépositionnel complément du groupe nominal environnement numérique.
- Poste de travail assis-debout :
- poste est le noyau;
- de travail est un groupe prépositionnel complément du nom poste;
- assis-debout est un adjectif composé complément du groupe nominal poste de travail;
- les mots assis et debout sont joints par un trait d’union, car on considère assis-debout comme une seule unité.
- Saute-soucis (un des mots gagnants du CCL 2019) :
- saute est une forme conjuguée du verbe sauter, qui a ici le sens de « passer quelque chose sans s’y arrêter »;
- soucis est un nom complément direct du verbe saute.
Activité
Observez les mots composés suivants. Ils sont formés d’un noyau (message) et d’un complément. Associez chaque mot à sa définition.
Mots
1° Message instantané 2° Message texte 3° Message d’urgence 4° Message privé 5° Message d’origine
Définitions
A2
Message adressé à une seule personne et accessible à elle seule.
B2
Message visant à rendre compte d’un danger.
C2
Message échangé en temps réel au moyen d’une application.
D2
Message alphanumérique échangé par ordinateur ou appareil mobile.
E2
Message de l’expéditeur qui est inclus dans la réponse à celui-ci.
4) Autres procédés
Les procédés de formation de mots présentés plus haut sont les plus fréquents, mais ce ne sont pas les seuls. Il est possible, par exemple, de donner un nouveau sens à un mot existant (comme
épingler i
dans le domaine de l’informatique, ou
pyramide i
dans le domaine de la planche à neige). Les néologismes peuvent également être formés par composition savante, à savoir par la soudure de deux éléments grecs ou latins, sans base (comme
vélocipède, de
véloci-, « vitesse », et de
‑pède, « pied »). Un mot existant peut aussi être tronqué, c’est-à-dire raccourci (comme
vélo, forme tronquée de
vélocipède).
Activité-synthèse
+
Mise en situation
Un défi a été lancé aux élèves de votre école, qui devaient créer des néologismes pour désigner le concept d’« apparition d’un chat dans l’écran d’une personne pendant une visioconférence ».
Nous vous demandons de faire partie du jury et de déterminer si les propositions conviennent pour désigner le concept ou si elles devraient être écartées.
Pour juger les propositions, appuyez-vous sur les caractéristiques du néologisme idéal mentionnées précédemment.
Bonnes délibérations!
Propositions
Appachatécran
Mot-valise formé à partir des mots apparaître, chat et écran.
Les deux premières syllabes du verbe apparaître (ap-pa-raître) sont conservées, ainsi que l’entièreté des mots chat et écran. Les mots n’ont aucun son en commun.
Ce néologisme ne se comprend pas clairement. En effet, l’amalgame de plusieurs éléments pour faire référence à toutes les caractéristiques du concept rend le mot-valise « opaque », c’est-à-dire que le lien entre le mot et le concept est difficile à établir. On pourrait, par exemple, penser que l’élément appa- renvoie plutôt au mot appât; la proposition signifierait alors « chose servant à attirer un chat devant l’écran ».
Cette proposition serait donc à écarter.
Cyberchat
Mot formé par dérivation :
+
préfixe cyber-, « dans Internet »
cyberchat
Ce néologisme est court et il respecte les règles du français.
MAIS… Le sens du mot résultant de la soudure du préfixe cyber- à la base chat est plutôt celui de « chat virtuel » ou de « chat existant sur Internet ». Ce néologisme ne convient donc pas pour désigner le présent concept.
Cette proposition serait donc à écarter.
Chabordage
Mot-valise formé à partir des mots chat et abordage.
Les trois syllabes du mot abordage (a-bor-dage) et celle du mot chat sont conservées; le son a est commun aux deux mots.
Ce néologisme est court et il respecte les règles du français. Le mot abordage peut évoquer de façon imagée une apparition inattendue et inopportune.
MAIS… Ce mot ne véhicule pas l’un des principaux traits du concept, soit l’idée de visioconférence. Ce néologisme ne convient donc pas pour désigner le présent concept.
Cette proposition serait donc à écarter.
Chat apparaissant en visio
Mot formé par composition :
- chat est le noyau;
- apparaissant est le participe présent du verbe apparaître;
- en visio est un groupe prépositionnel modificateur du verbe apparaître.
Ce néologisme n’est pas économique, le nouveau mot étant presque aussi long que sa définition.
Cette proposition serait donc à écarter.
Visiobombe féline
Mot formé à partir de deux procédés – le télescopage (mot-valise) et la composition :
- visiobombe est un mot-valise formé à partir de visioconférence et de bombe;
- visiobombe est le noyau;
- féline est un adjectif complément du nom visiobombe.
Ce néologisme est relativement court, il se comprend bien et il respecte les règles du français. Plus encore, les éléments qui le composent font référence aux traits essentiels du concept : la visioconférence avec visio, l’apparition brusque et inattendue avec bombe, et le chat avec l’adjectif féline.
Cette proposition pourrait donc être retenue.
Télémistigrisme
Mot formé par dérivation :
+
préfixe télé-, « à distance »
+
base mistigri, synonyme familier de chat
+
suffixe -isme, « activité »
télémistigrisme
Bien que ce néologisme soit court et qu’il respecte les règles du français, il se comprend difficilement. Le préfixe télé- signifie « à distance »; l’utilisation de ce préfixe n’est pas suffisante pour faire référence à la visioconférence. Mistigri est un joli mot habituellement employé dans la langue familière. Toutefois, le lien entre ce mot et le concept de « chat » peut être obscur pour certaines personnes.
Cette proposition serait donc à écarter.